Ce qui reste

Aujourd’hui, une jeune fille et un souvenir de l’amour et des sens. “Ce qui reste”, de Nasha.
On découvrait avec étonnement, puis ravissement la maison. Parce qu’elle avait l’apparence d’un immeuble cossu délabré. C’était le souvenir d’un amour : David.
La maison de son père était ce dont je me souvenais immédiatement : j’aimais laisser mes pensées s’y perdre, c’était une douce nostalgie. La première fois que j’y avais été invitée, j’étais seule avec lui. Son père voyageait. Porte de Clignancourt n’était pas un quartier très… chic. Il ne correspondait pas à l’image de son père : sociologue au CNRS, un « juif-italien » bel homme, très cultivé. Nous avions traversé les quelques rues qui nous rapprochaient de la maison, et je découvrais un véritable marché aux puces – pas celui de Genève, le seul que je connaissais, aux allures très « propres » de brocante – sous le pont d’une voie rapide, et je voyais des enfants sales, qui jouaient sur des matelas crasseux et troués déposés devant des toilettes publiques, dont l’odeur me soulevait le cœur si j’oubliais de ne pas respirer – ce qui n’arriva jamais…
Il fallait s’enfoncer plus loin, passer le pont, pour arriver à la maison. Les rues étaient sales, tout était gris malgré le ciel bleu et un froid d’hiver presque aseptique qui n’arrêtait pourtant pas les mauvaises odeurs – tout sentait mauvais, je ne savais pas quoi exactement. Je ne savais plus non plus ce que j’allais découvrir. Je me sentais mal à l’aise. Je déteste la misère du monde, je déteste y penser car je ne peux rien faire et, surtout, je n’ai pas l’assurance d’en être épargnée pour toujours. Et voilà que j’allais être parmi elle chaque fois que nous traverserions le quartier. Je prendrai le bras de David et baisserai les yeux jusqu’au métro qui nous conduirait jusqu’aux belles avenues de Paris.
David souriait de mon silence, il n’était pas gêné d’avoir à marcher dans ces rues miséreuses avec moi. Il savait que la maison me plairait : il ne m’en avait rien dit, je savais seulement que le dernier étage serait tout à nous. Il ne regardait pas, comme moi – du moins pas de la même façon – ce qui nous entourait. Il avait hâte de rentrer, son pas était rapide. Il me tenait la main et j’étais derrière lui, comme une petite fille.
C’est souvent comme ça que je me sentirais lorsqu’on parcourait les rues de Paris que j’avais oubliées, et que lui connaissait par cœur. La maison de son père était la dernière de la rue. C’était la plus jolie. Elle était étroite, toute en hauteur. Les nombreuses fenêtres de la façade, hautes et étroites, sans rideaux, laissaient croire à un immeuble. La maison semblait être là depuis toujours. C’était un véritable bonheur d’y vivre. Elle abritait un univers de livres, d’art pour la plupart, et des magazines et de nombreux CD. C’était un joyeux bordel organisé. Les livres empilés sur des tabourets, que la moindre brise d’air semblait déséquilibrer un peu plus, bizarrement ne tombaient jamais. Il y avait des mobiles en bois et en papier accrochés au plafond. Et des reproductions d’œuvres de Nicolas de Staël dans des sous-verres, ainsi que de nombreux dessins dans des cadres en bois clair. D’ailleurs, on respirait partout dans la maison le bois et la peinture, et un peu l’humidité. Je m’y suis plu tout de suite. J’oubliais qu’on était Porte de Clignancourt. David et moi occupions toujours le dernier des trois étages. C’était génial : on montait jusqu’à la terrasse – le toit – d’où nous voyions le quartier et au-delà. Le plafond de la chambre était constitué de fenêtres par lesquelles, allongés dans le lit, on voyait le ciel. On laissait traîner nos affaires partout. On constituait notre joyeux bordel organisé. C’est là que nous décidions – que je décidais, en fait – de nos plans pour la journée. David était très beau, il portait les affaires qu’il avait laissées dans cette maison avant de partir étudier à Annecy. Toutes les fois qu’on s’y rendait, tout allait mieux entre nous. Tout était léger. Comme si notre amour nous assurait lui-même de sa vérité, sans qu’on ait à faire le moindre effort. Ça faisait tellement de bien. Peut-être parce que nous étions seulement tous les deux, qu’on avait plus qu’à veiller l’un sur l’autre. Nos amis n’étaient pas là : nous n’avions plus à les distraire ni à nous laisser distraire. Il y avait le silence aussi : on pouvait cesser de parler. Le silence dans cette maison ne gênait pas : il était apprécié. Nous n’aurions pas été bien ensemble si le silence avait gêné l’un de nous. C’est dans cette chambre que nous faisions le mieux l’amour. Non pas pour éviter de se disputer, de dire des choses désagréables, de ne pas montrer qu’on avait passé une mauvaise journée, qu’on s’ennuyait ou parce qu’il le fallait. On faisait l’amour parce qu’on en avait envie, que ça faisait du bien, qu’on était beaux et que c’était magnifique de voir le ciel lorsqu’on était allongés. J’avais conscience de tout l’amour que David avait pour moi. Je me souviens qu’il paraissait plus fort et confiant quand j’étais là, et j’aimais cela. J’aimais être là quand il le voulait, j’aimais qu’il veuille faire l’amour à chaque fois que nous nous glissions dans les draps du lit, ou qu’il se réveillait avant moi. On se désirait tout le temps, dans cette maison, Porte de Clignancourt. Il y avait toujours de la musique. Bruce Springsteen, Cat Stevens, The Police, The Clash, The Doors, The Cure… Nous arrêtions de penser, nous ne faisions plus que l’amour, les jours ou nous décidions de ne pas sortir. Lorsqu’il pleuvait nous restions dans l’obscurité, nous n’aimions pas l’éclairage artificiel. On allumait de faibles lumières et cela suffisait.
C’est l’atmosphère de la maison que je n’oublie pas et qui me rappelle David et moi : les marches de l’escalier en moquette, encombrées par des piles de livres qu’il fallait monter pour parvenir à la chambre, la lumière de l’extérieur dont l’intensité changeante pénétrait la chambre par les grandes vitres, le bruit de pas des pieds nus de David en bas que j’entendais encore allongée, le matin.







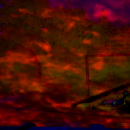


Basquiat à la Fondation Vuitton: la visite enchantée
La complainte du marin moderne : la poésie comme dessein